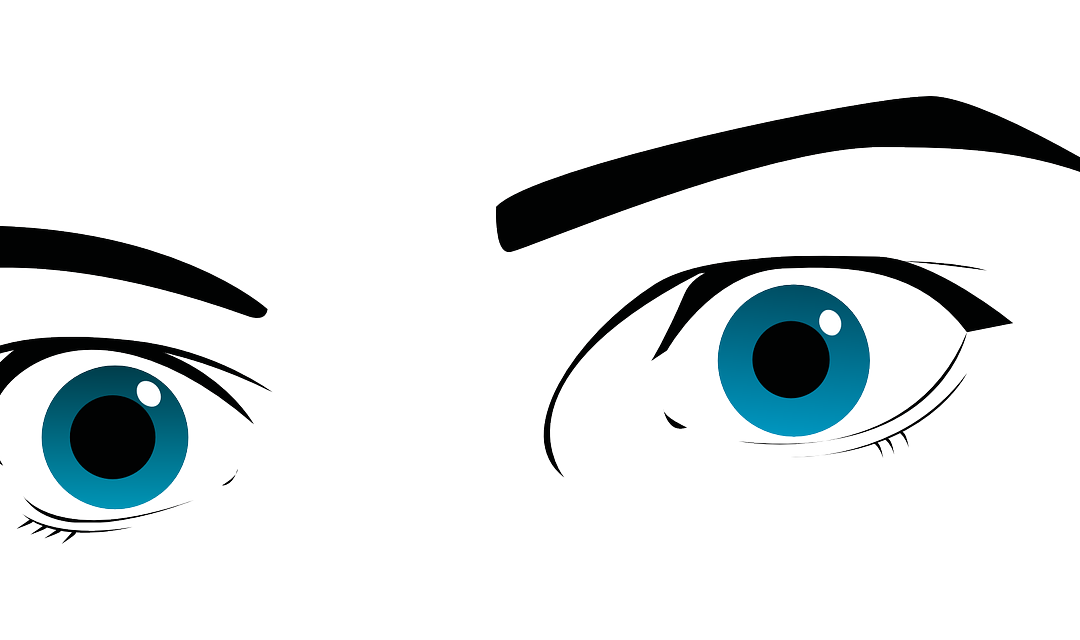Je suis là, allongée sur mon lit d’hôpital. Tout ce que je sais, c’est que je suis vivante et que je suis dans la capacité de réfléchir, de penser, de formuler des mots et des expressions dans ma tête. Des personnes viennent me rendre visite, mais je ne les connais pas. Elles semblent me connaître par cœur, me révéler mes qualités comme mes défauts avant même de me dire quels sont mon prénom et mon âge. Je suis consciente qu’elles m’agacent profondément, mais impossible de l’exprimer. Elles osent me faire la bise, m’embrasser sur le front et m’interroger comme si on était à la CIA. Je les déteste.
Elles pensent que je suis un gros bébé. Visiblement, aucune expression valable n’apparaît sur mon visage, encore moins dans mes gestes, dans mes postures. Il paraît que je suis vide, vide de sens, de signification des maux éprouvés. Des douleurs s’insinuent dans mon corps, et je ne peux pas les situer. Un corps, je ne suis qu’un corps, un phénomène physique qui a perdu toute possibilité d’interagir avec les autres. Un objet, un truc que l’on trimbale du lit à la salle de bain, et encore, il faudrait que l’aide-soignant soit assez fort pour me transporter. Souvent, on me lave là, à même le lit. Et je me sens mouillée et humide toute la journée. Et quand on n’arrive pas à parler ou à indiquer ces gênes, rien n’est fait pour nous aider. C’est fou, les êtres humains, ils passent d’un malade à un autre avec l’utilisation d’un chronomètre, une heure de sortie, une performance exigée par le directeur de l’hôpital. C’est quoi cette époque, ce monde dans lequel j’ai atterri ? N’aurais-je pas mieux fait d’y rester ? De rester dans quoi, d’ailleurs ? J’entends « accident », « voiture », « camion », « victimes », « cellules de crise », « la pauvre »… et je ne peux participer à tout ce méli-mélo de mots et de termes grossiers à mon égard.
Et puis, une jeune fille apparaît. Elle m’appelle maman. C’est mon prénom ? Non, c’est le rôle qu’elle me donne auprès d’elle. Elle est plutôt jolie, mais si triste que je n’ai qu’une envie, la foutre dehors. Elle pleure, regrette, se plaint, essuie ses larmes, me prend la main, me caresse, me regarde dans les yeux, demande pardon…de je ne sais quoi, de son absence due à son travail, ses enfants, son mari…sa vie, quoi… Elle finit par prendre conscience que je n’ai que faire de ses sentiments débiles, et que tout ce que je souhaite maintenant, c’est mon prénom, mon âge, les raisons de ma présence ici, de mon mutisme, les séquelles, si je vais m’en sortir, si je vais pouvoir reprendre le contrôle de ma vie et échapper à tout ce qui me dérange. L’odorat est devenu mon sens premier. Je détecte l’odeur des visiteurs et je sais si je vais passer ou non un bon moment. Ce qui est curieux, c’est que cet homme qui se dit mon mari, je ne supporte pas son odeur. N’est-il pas en train de me jouer un tour ? Je ne le trouve pas beau, pas avenant, pas vraiment gentil, plutôt grossier… Il m’avoue que nous sommes mariés depuis plus de vingt ans, que nous dormons dans le même lit depuis plus de vingt-cinq ans, que nous avons eu deux enfants, que nous avons voyagé si souvent qu’il ne se rappelle plus les lieux visités.
Le médecin me rend visite, agite son stylo devant mes yeux, prend ma fiche et m’appelle par mon nom de famille. Il dit que tout va bien. Ben non, rien ne va. Il affirme que mon état est stable, mais oui, il est trop stable ! Il faut qu’il m’aide à sortir de cette torpeur, de ce cloisonnement. Il m’affole, j’ai peur de rester dans cet état. Je préfère mourir. Même ça, je ne peux le balancer. Je veux mourir plutôt que d’être aux mains de ces incapables !
Enfin, une orthophoniste est venue, et nous avons toutes les deux trouvé le moyen de communiquer. Avec le clignement de mes yeux, j’ai réussi à lui répondre… Et par ce contact qui a eu du sens pour moi, j’ai réussi à ressentir de l’espoir…
La relation qui prend du sens pour nous nous réveille à nous-même.
Qu’en dites-vous ?
Mes ouvrages intitulés De la folie pure et Organique se rapprochent de cette histoire.
Vous trouverez d’autres articles sur mon site web: https://joelineandriana.com.
Toutes les vidéos, audios et articles de ANDRIANA Joéline (AJ) sont à voir et à lire gratuitement et en intégralité sur:
https://joelineandriana-auteur.com
Abonnez-vous à la chaîne AJ : https://youtube.com/@joelineandriana?feature=shared
Toutes les vidéos sur https://youtube.com/@joelineandriana?feature=shared
Rejoignez mon podcast AJ :
https://www.podcastics.com/podcast/8868/link/
ANDRIANA Joéline sur les sites :
https://joelineandriana-auteur.com
AJ sur Twitter :
https://x.com/joelineandriana?s=21
https://www.facebook.com/share/14GzXyq69JK/?mibextid=wwXIfr
AJ sur Instagram :
https://www.instagram.com/joelineandriana?igsh=anVxN3k0MHZlejBu&utm_source=qr
https://www.tiktok.com/@joelineandriana?_t=ZN-8xJcvVVMAx4&_r=1
********************************************
Subscribe to AJ channel : https://youtube.com/@joelineandriana?feature=shared
All the videos : https://youtube.com/@joelineandriana?feature=shared
AJ website :
https://joelineandriana-auteur.com
https://x.com/joelineandriana?s=21
Follow us on Facebook :
https://www.facebook.com/share/14GzXyq69JK/?mibextid=wwXIfr
Follow us on Instagram :
https://www.instagram.com/joelineandriana?igsh=anVxN3k0MHZlejBu&utm_source=qr
Follow us on Tik Tok :
https://www.tiktok.com/@joelineandriana?_t=ZN-8xJcvVVMAx4&_r=1